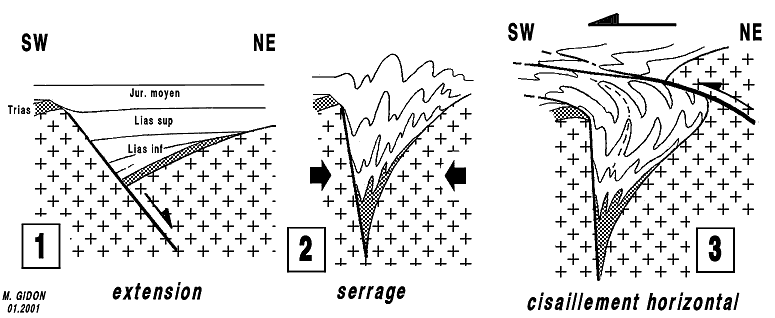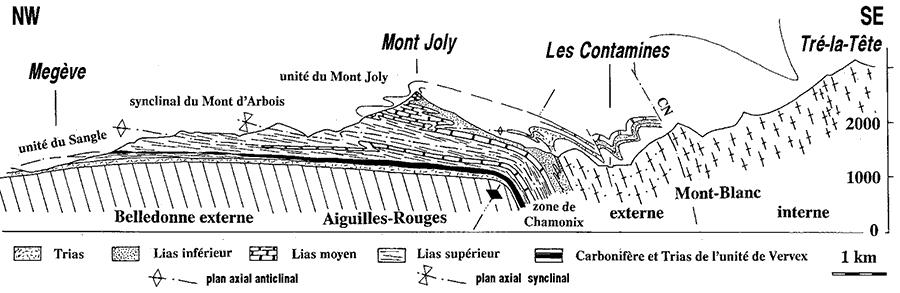Coupes structurales des massifs de la section Mont Blanc
1/ Secteur des Aiguilles Rouges -
Mont-Blanc
version plus grande 
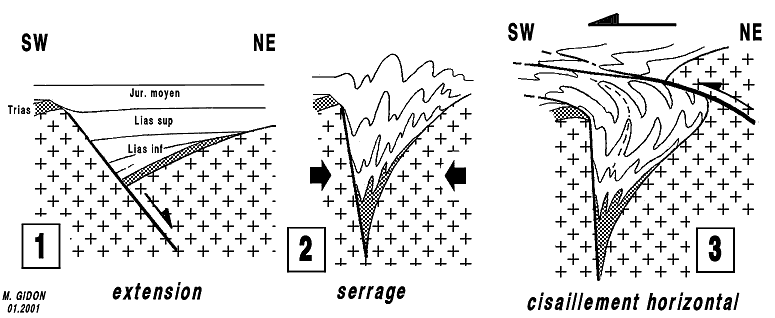
Schéma interprétatif de la déformation
des hémigrabens des massifs cristallins externes
spécialement inspiré par les exemples des "synclinaux"
de Bourg-d'Oisans, de la Muzelle, de la Vaurze et de Morges (l'orientation
est celle de ces deux derniers), mais également appliquable
aux secteurs d'Arêches (le sédimentaire chevauchant
du schéma 3 correspondant à l'unité de Roselend),
du Val Montjoie (le cristallin chevauchant du schéma 3
pourrait figurer la "nappe" de Roselette) et de Chamonix.
N.B. : Si ce schéma paraît s'adapter à la
plupart des exemples connus, il n'est pas certain que la chronologie
soit la même dans tous les cas (c'est pourquoi aucun âge
n'est indiqué). Les épisodes 2 et 3 correspondent
à deux processus complémentaires, liés respectivement
au raccourcissement (notamment du socle) et au déplacement
relatif de la couverture (entrainée par les nappes internes)
par rapport au socle. Ils peuvent s'être succédé
en ordre inverse, ou même avoir été plus ou
moins contemporains.
2/ Secteur de Megève - val
Montjoie
image
plus grande >  nouvelle fenêtre
nouvelle fenêtre
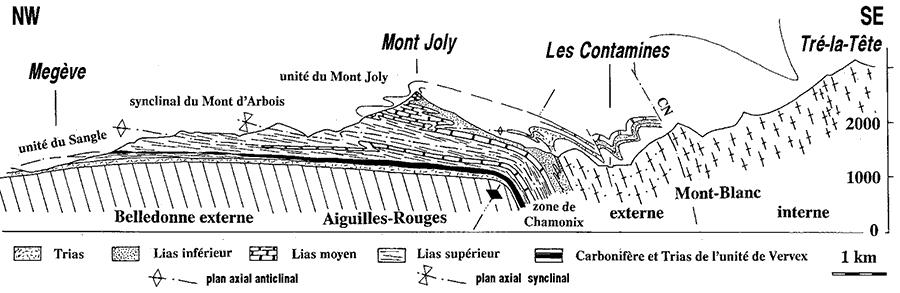
Coupe d'ensemble du chaînon du Mont-Joly et de ses abords
Cette coupe résume les conclusions de l'étude
d'ensemble la plus récente sur les environs du Mont-Joly
(son auteur se rallie à une interprétation par plis
couchés très aplatis, voire étirés). (d'après J.L.Epard,
1990, légèrement retouché)
J.L.Epard distingue, sous une "unité du Mont-Joly",
qui serait un anticlinorium couché, un "synclinal
du Mont d'Arbois", à coeur de schistes du Toarcien
et de l'Aalénien, puis une "unité du Sangle"
formée de Lias calcaire en série renversée,
qui serait le flanc inverse d'un pli-couché très
aplati. Le tout reposerait, par une surface de chevauchement,
sur une lame de carbonifère et de Trias, l'"unité
de Vervex", elle même décollée et trainée
sur le socle autochtone.
L'absence de Lias calcaire dans le flanc normal supposé
du pli couché de l'unité du Sangle impose à
J.L.Epard une explication complémentaire, qu'il propose
de trouver dans une discordance synsédimentaire sur le
flanc d'un bloc basculé.
J.L.Epard reconnait d'autre part 3 phases de déformation
: la première aurait créé les grands plis-couchés,
la seconde aurait vu leur reploiement par des plis à déversement
vers l'ouest et la troisième aurait cintré la voûte
du massif de Belledonne et créé une charnière,
déversée vers l'est, entre le massif des Aiguilles
rouges et la zone synclinale de Chamonix.
|
version plus grande 
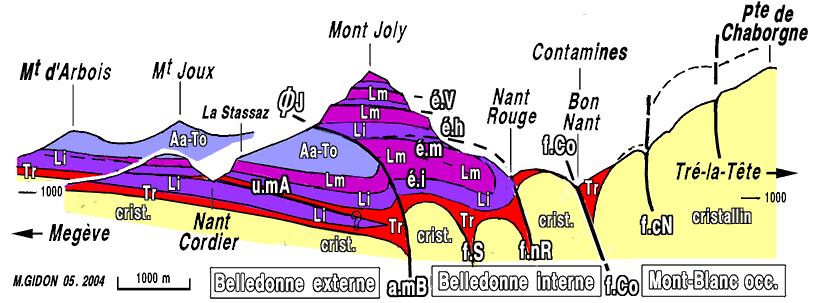
Coupe d'ensemble du chaînon du Mont Joly et de ses abords
u.mA = Unité
du Mont d'Arbois ; a.mB = prolongement hypothétique de l'accident médian de Belledonne ; f.Co = faille des Contamines (grand décrochement N-S) ; f.cN = faille de Combe Noire (délimitant le "claveau"
le plus occidental du rameau externe du Mont-Blanc) ; f.nR = faille du Nant Rouge ; f.S = faille du Sallestet.
Ø.J = surface de chevauchement de l'Unité du Joly. Les écailles dénommées au sein de cette unité sont de haut en bas : é.V = écailles du Véleray ; é.h = écaille haute de l'Aiguille Croche ; é.m = écaille médiane de l'Aiguille Croche ; é.i = écaille inférieure de l'Aiguille Croche.
Aa-To = schistes aalénien et toarciens ; Lm = Lias moyen (Carixien - Lotharingien) ; Li = Lias inférieur (Sinémurien - Hettangien) ; Tr = Trias.
|
version plus grande 
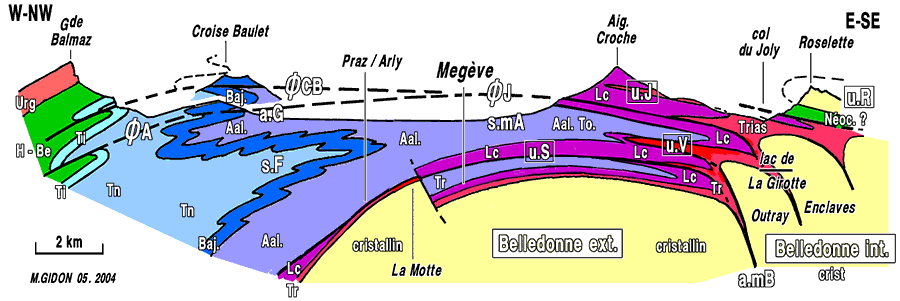
Schéma des rapports entre les structures du
val Monjoie et celles du revers
oriental des Aravis
Ce schéma exprime l'interprétation selon
laquelle le synclinal du Mont d'Arbois représente le prolongement
du synclinal de Flumet de la rive nord-ouest de la vallée
de l'Arly. Le chevauchement du Joly apparaît alors
comme un accident similaire au chevauchement d'Areu, voire même
comme son prolongement plus bas dans la succession stratigraphique,
au niveau du Lias. ØA = chevauchement d'Areu ; ØCB = chevauchement de Croise Baulet ; ØJ = chevauchement
du Joly
u.J = unité du Joly ; s.mA = "synclinal "
du Mont d'Arbois ; u.V = unité de Vorès ; u.S = unité du Sangle; u.R = unité de Roselend - Roselette ; a.mB = accident médian de Belledonne.
|
3/ Secteur du Beaufortain
|
légende
des couleurs de ces coupes
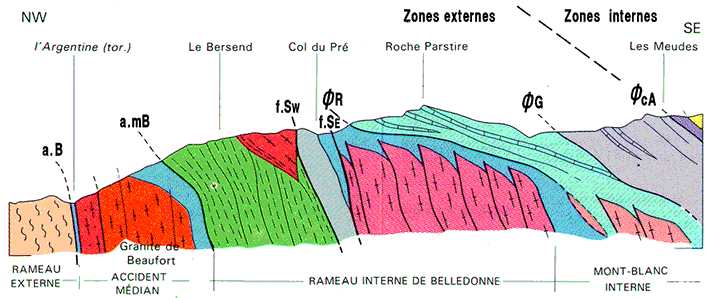
Coupe structurale du Beaufortain occidental au
nord d'Arêches
amBW = accident médian de Belledonne
(branche ouest) ; amBE = accident
médian de Belledonne (branche est) ; f.SW
= faille occidentale du Sallestet ; f.SE
= faille orientale du Sallestet
ØR = surface de chevauchement de l'Unité
de Roselend ; ØG = surface de chevauchement de
l'Unité de la crête des Gittes ; ØcA
= surface de chevauchement de l'Unité du Cormet d'Arêches
(première unité rattachée au domaine des
nappes internes)
(coupe extraite de la notice de la carte géologique,
feuille Bourg-Saint-Maurice, retouchée)
NB 1 : Le débitage en lames imbriquées
du socle cristallin du rameau interne de Belledonne correspond
à une interprétation qui se révèle
peu en accord avec les faits d'observation : ceux-ci plaident
plutôt en faveur d'un framgmentage du socle en blocs par
des failles ayant des rejets extensifs et/ou coulissants.
NB 2 : L'unité de Roselend est
la première unité chevauchante ("parautochtone")
de l'autochtone dauphinois interne.
Dans la notice de la carte Bourg-Saint-Maurice elle est appelée
"écaille de la Gitte". Mais ce terme
prète à confusion avec l'"unité
de la crête des Gittes" immédiatement
plus interne.
L'unité de Roselend ainsi définie se prolonge plus
au sud par l'"unité de la Roche Parstire - Roc Marchand"
et rangée dans les "unités décollées"
de la légende du schéma
structural de la carte. Elle est distincte de l"unité
de Roselend" de P.LANDRY (1976), pour qui ce terme désignait
la couverture sédimentaire autochtone du rameau interne
de Belledonne
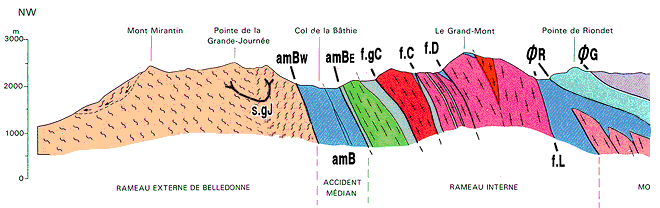
Coupe du Beaufortain occidental (autochtone), au sud d'Arêches
s.gJ = synforme de la Grande Journée ; amBW = accident de Beaufort ; amBE = accident
médian de Belledonne ; f.gC = faille
de la Grande Combe ; f.C = faille de Cuvy (prolongement
sud de la faille occidentale du Sallestet) ; f.D = faille
du Dard (prolongement sud de la faille orientale du Sallestet)
; f.L = faille de la Louze
ØR = surface de chevauchement de l'Unité
de Roselend ; ØG = surface de chevauchement de
l'Unité de la crête des Gittes.
(coupe extraite de la notice de la carte géologique,
feuille Bourg-Saint-Maurice, modifiée)
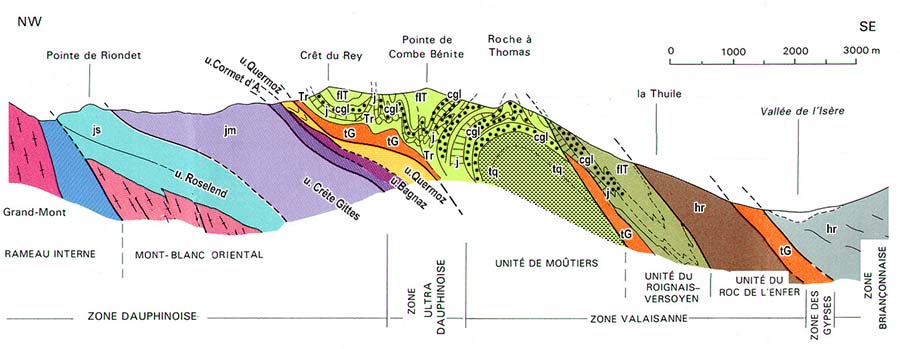
Coupe du Beaufortain oriental à l'est
d'Arêches
js = Jurassique supérieur de l'Unité de
Roselend ; jm = Jurassique moyen de l'Unité
de la crête des Gittes ; tG = surfaces tectoniques jalonnées de trias gypsifère ; Tr
= Trias carbonaté de la zone valaisanne; j
= Lias et Dogger de la zone valaisanne ; cgl = conglomérats de base du flysch de Tarentaise
; flT = flysch de Tarentaise ; hr = grès et schistes houillers.
(coupe extraite de la notice de la carte géologique,
feuille Bourg-Saint-Maurice, présentation fortement retouchée)
|
Abréviations utilisées pour désigner les principales cassures et surfaces de chevauchement
:
Massifs septentrionaux (Aiguilles Rouges, Mont-Blanc, val
Montjoie) :
u.J = unité du Joly ;
s.mA = synclinal du mont d'Arbois ;
u.S = unité du Sangle (série liasique inférieure
de Megève) ;
f.C = faille de Chamonix ;
f.cN = faille de Combe Noire
Beaufortain occidental :
amBW = accident médian
de Belledonne (branche ouest) ;
amBE = accident médian de Belledonne
(branche est) ;
f.gC = faille de la Grande Combe ;
f.C = faille de Cuvy ;
f.D = faille du Dard ;
f.L = faille de la Louze.
Beaufortain oriental :
ØR = surface de chevauchement de l'Unité
de Roselend ;
ØG = surface de chevauchement de l'Unité
de la crête des Gittes (u.G = u.cr.G) ;
ØcA = surface de chevauchement de l'Unité
du Cormet d'Arêches ;
ØB = surface de chevauchement de l'Unité
de la Bagnaz ;
ØQ = surface de chevauchement de l'Unité
du Quermoz ;
ØM = surface de chevauchement de l'Unité
de Moûtiers ;
ØR = surface de chevauchement de l'Unité
du Roignais ;
ØrE = surface de chevauchement de l'Unité
du Roc d'Enfer ;
ØhB = surface de chevauchement de la nappe du Houiller
briançonnais.