Saint-Égrève, Rochers de l'Église |
La localité de Saint-Égrève est installée, en rive droite de l'Isère, sur le grand cône de déjections torrentielles qu'a construit le torrent de la Vence, au débouché des gorges qu'il a entaillées dans le contenu tertiaire du synclinal de Proveysieux, là où ce dernier s'enfonce sous les alluvions de la trouée de l'Isère. Saint-Égrève est le point de départ de la route D.105, qui s'élève en suivant le vallon de Proveysieux jusqu'au col de la Charmette (voir la page "Proveysieux").
Du côté septentrional l'agglomération s'étend vers le nord-est jusqu'au village de La Monta, c'est-à-dire au débouché de la Vence dans la plaine alluviale et au sommet de son cône de déjections : elle s'y s'appuie contre les affleurements de molasse conglomératique du coeur du synclinal.
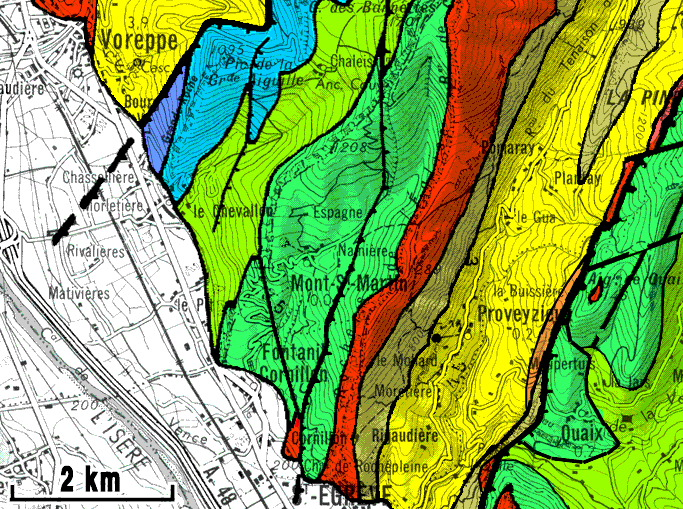
|
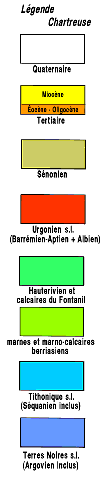
|
|
|
|
| Le Fontanil | LOCALITÉS VOISINES | Néron |
|
|
|
|
Saint Egrève |
|