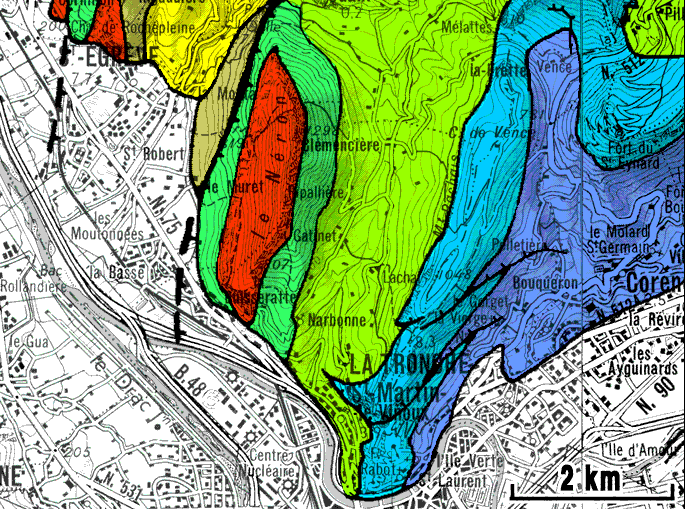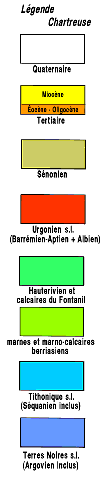Les pentes supérieures de la Bastille et le Mont Jalla |
la partie haute de l'éperon méridional du massif
de la Chartreuse
PAGE ABANDONNÉE
retrouvez son contenu à la page Rachais
Au nord des bâtiments du fort de la Bastille et de la gare du téléphérique, s'étend la plateforme de la Bastille, au nord de laquelle la pente de la montagne recommence à s'élever en direction du Mont Jalla. Pour l'essentiel ce dernier est constitué par les calcaires tithoniques du flanc occidental
de l'anticlinal de l'Écoutoux, dont les bancs pendent dans l'ensemble fortement, vers l'ouest.
image sensible au survol et au clic
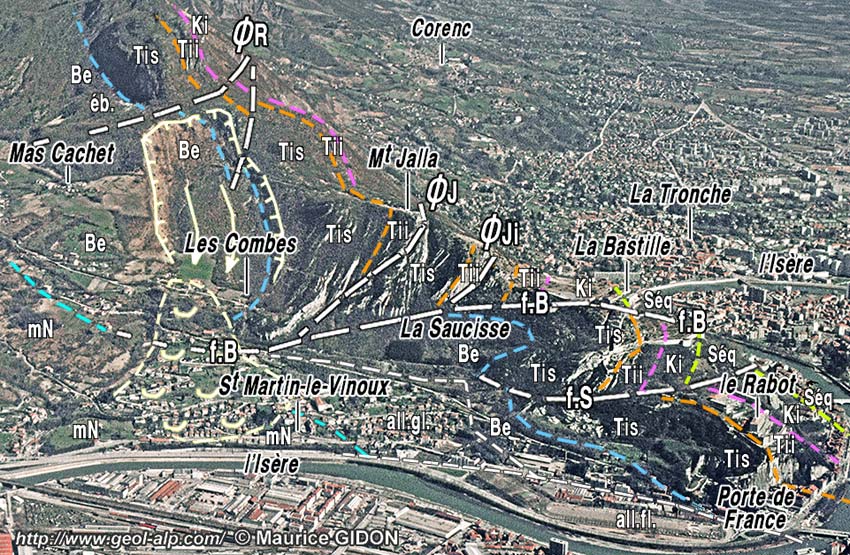
L'éperon rocheux de La Bastille, vu de l'ouest, d'avion.
Les couches qui le constituent sont affectées par deux sortes de failles (voir le schéma interprétatif en fin de page) :
failles anté-plissement : ØJ = chevauchement supérieur du Jalla
; ØJi = chevauchement inférieur du Jalla
; ØR = chevauchement du Rachais ;
failles post-plissement : f.B = faille de La Bastille ; f.S = faille de La Saucisse.
On a indiqué l'arrachement ancien des Combes (flèches) avec sa crevasse de détachement (trait barbulé) et sa loupe de glissement (lunules).
|
Un examen relativement fouillé de cette partie de la montagne a mis en évidence (cf publication n°094) des détails structuraux qui, pour être mineurs se sont néanmoins révélés importants à prendre en compte pour reconstituer la succession des évènements tectoniques qui sont intervenus dans l'édification du massif de la Chartreuse : cette reconstitution est présentée en fin de page.

Le Mont Jalla et le rebord ouest de la plateforme de la Bastille vus depuis le belvédère de la gare du téléphérique (monument aux géologues grenoblois).
f.J = faille principale (supérieure) du Jalla ; f.Ji = faille secondaire (inférieure) du Jalla ; f.B = faille de la Bastille.
Ki-tr = couches de transition Kimméridgien-Tithonique (niveaux supérieurs du Kimméridgien ; cf. texte).
|
La plateforme de la Bastille a été aménagée
du côté septentrional par creusement dans les couches du Kimméridgien inférieur (calcaires argileux en petits bancs séparés par des lits de marnes) puis dans celles de la transition Kimméridgien-Tithonique (bancs calcaires métriques à minces lits marneux). Ces dernières sont percés d'une galerie sous roche ouverte de fenêtres
successives (dénommée "grottes de Mandrin").
Toutes ces couches, qui appartiennent au flanc occidental
de l'anticlinal de l'Écoutoux, ont ici un pendage presque vertical.
|

L'extrémité septentrionale de la plate-forme
de la Bastille ("Grottes de Mandrin"), vue du sud.
L'entaille pratiquée dans la montagne pour fournir
les matériaux de la plateforme (tout en étendant
sa surface vers le nord), a mis au jour une bonne coupe de la
succession des couches de la formation traditionnellement dénommée
"Kimméridgien"
dans notre région (c'est plus exactement le "Crussolien",
c'est-à-dire l'équivalent du seul Kimméridgien
inférieur des anglais). Les petits bancs à joints
argileux du "Kimméridgien inférieur" (au
sens local) se poursuivent vers la droite jusqu'au départ
de la route forestière du Jalla (voir cliché
suivant)
Du côté gauche (ouest) le creusement a dégagé
un mur naturel qui correspond à une surface de cassure,
bien caractérisée par ses enduits calcitiques porteurs
de stries et par le fait qu'elle est oblique aux surfaces de strates
(s0). Il ne s'agit que d'une petite faille très
mineure (à rejet métrique) que l'on ne suit guère
plus haut dans la succession des couches.
Cette cassure coupe d'ailleurs les couches selon un angle très
aigu, ce qui ferait penser à une faille inverse (compressive).
Mais son rejet s'avère être de sens opposé,
extensif. Ces caractères, plutôt exceptionnels dans
le secteur, ne s'expliquent ni dans le cadre de la formation de
l'anticlinal de l'Écoutoux ni dans celui des déformations
compressives antérieures. Son origine est donc assez conjecturale
...
|
À l'extrémité orientale
de cette plateforme, juste à gauche de l'embranchement
de la route forestière du Jalla, on peut observer que les
plus basses de ces couches sont affectées d'un enchaînement
de deux plis de taille métrique, l'un anticlinal l'autre
synclinal . Ils ont des plans axiaux inclinés vers l'ouest
et des axes qui plongent assez fortement vers le nord (vers l'intérieur
de la montagne). Mais, si l'on tient compte de la polarité
stratigraphique, on se rend compte que le pli antiforme* est en
réalité un synclinal et le pli synforme* un anticlinal.
D'autre part leur forme "en S" ne s'accorde pas avec
le dessin "en Z" que devraient présenter, vus
sous cet angle, des "plis parasites" formés avec
l'anticlinal de l'Écoutoux (tels que ceux analysés
à la page "square
Cularo").
Ces microplis sont donc nécessairement étrangers
à la formation des grands plis régionaux. L'interprétation
la plus cohérente avec les autres données structurales
est de considérer qu'ils sont antérieurs. Originellement
déversés vers l'ouest, ils auraient été
ensuite basculés de près de 90° vers l'ouest
en même temps que toutes les couches du flanc ouest de l'anticlinal
de l'Écoutoux (voir la remarque annexe, ** ci-après).
image sensible au survol et au clic

Le soubassement du départ de l'ancien télésiège,
à l'extrémité nord de la plate-forme de La
Bastille (immédiatement à l'ouest du départ
du chemin du Jalla et du restaurant "Père Gras").
Plis métriques dans les bancs à alternances
marneuses du Kimméridgien inférieur (des faisceaux
de bancs à forts lits marneux alternent avec d'autres où
les marnes n'occupent que des joints d'épaisseur centimétrique
entre les bancs calcaires). .
Les noms "anticlinal" et "synclinal" désignent
les plans axiaux des plis, plans qui ont un pendage vers l'ouest. L'axe des plis
est en outre fortement plongeant vers l'arrière (c'est-à-dire
vers le nord). Les flèches indiquant HAUT et BAS (en bas du cliché) se rapportent
à l'ordre de succession stratigraphique des couches.
Ces plis sont typiquement "en S" ; ils sont schématisés et placés dans
leur contexte dans la coupe supérieure de la figure
ci-après (où ils sont désignés
par X').
pour plus de détails et de commentaires, voir la publication n°094.
|
Le sommet du Mont Jalla lui-même (620 m.) est un simple replat sur l'échine
qui monte de la Bastille au Rachais (voir la page "Rachais"). Il portait des installations
(maintenant ruinées) permettant l'évacuation de
la pierre à ciment "de la Porte de France" (exploitée
en galeries au flanc ouest de la montagne, à ce niveau).
Le ressaut rocheux qui domine La Bastille montre, en coupe naturelle et avec une belle
clarté, le passage d'une faille qui recoupe les couches du Tithonique avec une faible obliquité (c'est-à-dire selon un angle commun pour les failles compressives).
|

Vue d'ensemble, du
sud, depuis l'épaulement entre 560 et 570 m d'altitude,
au dessus de la plate-forme de la Bastille.
Le Tithoniquedu flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux)
est ici redoublé par la faille
de chevauchement supérieure du Jalla (ØJ). Elle plonge fortement vers la gauche, mais un peu moins que les couches (s0), avec lesquelles elle fait
un angle aigu, comme il convient à une faille "inverse"*.
|
Elle provoque un redoublement des couches et présente en outre des crochons qui indiquent qu'il s'agit d'un accident
compressif à vergence* ouest.
|
image sensible au survol et au clic
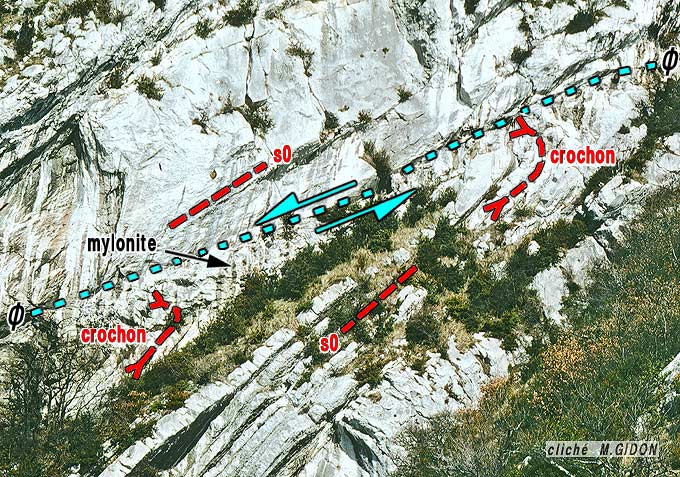
Vue plus rapprochée du chevauchement
montrant les détails - biseautage des couches,
crochons synclinaux dans le compartiment inférieur - qui
permettent de déterminer le sens du mouvement : le compartiment supérieur s'est déplacé
vers la gauche, donc vers le bas actuel.
|
Son pendage, vers l'ouest, est peu en accord avec le sens de mouvement ainsi indiqué (avec ce pendage on s'attendrait "normalement" à une vergence est). Mais cette géométrie est aisément expliquable si l'on admet qu'il s'agit d'une faille de chevauchement qui a été basculée postérieurement à son fonctionnement : ces basculement est aisément attribuable à un effet du plissement qui a basculé dans le même sens les couches du flanc ouest de l'anticlinal de l'Écoutoux (voir la remarque annexe, ** ci-après).
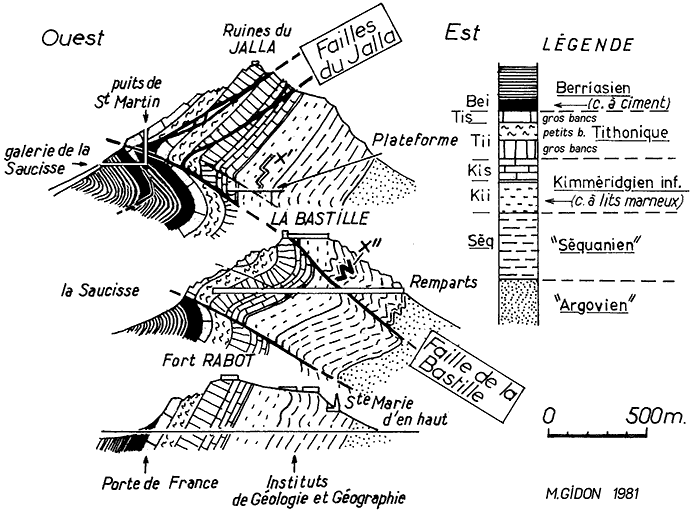
Coupes dans l'éperon de la Bastille et du
Mont Jalla
Les failles du Jalla sont des failles de chevauchement,
à vergence ouest, qui ont été basculées
par la formation de l'anticlinal de l'Écoutoux.
Les microplis indiqués en X' sont ceux de la famille illustrée ci-dessus.
Ceux de la famille X'' s'observent notamment en pied de montagne,
au square Cularo.
|
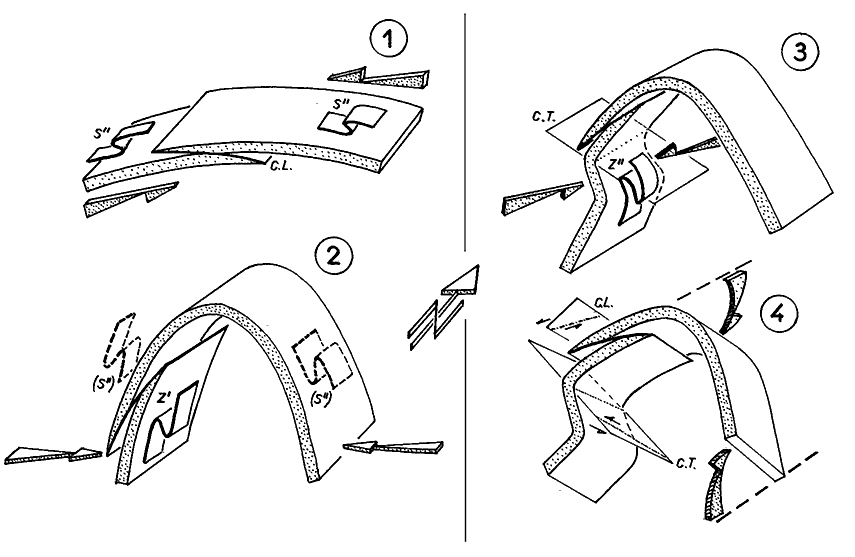
Schéma de l'évolution tectogénétique
de l'anticlinal de l'Écoutoux et du chaînon Bastille
- Jalla - Rachais.
1 . Étape précoce du serrage ("phase P1"), avec cisaillement
d'est en ouest. créant les chevauchements longitudinaux, tels ceux du Jalla et du Rachais (C.L.) et les plis de type S".
2. Étape de raccourcissement ("phase P2")
de formation des grands plis orientés N-S, par flexion de
la voûte des ébauches de plis antérieurs (anticlinal de l'Écoutoux) : Basculement des plis S"
antérieurement formés (en tiretés) et apparition
des plis Z'.
3. Étape de cisaillement chevauchant dans le
sens du NE vers le SW: formation des chevauchements transversaux, telle la faille de La Bastille (C.T.) et des plis S'; torsion des plis Z' qui deviennent des
plis Z".
4. Basculement d'ensemble vers le Nord ("phase P3", associée au soulèvement de la chaîne de Belledonne), cause du plongement axial de l'anticlinal de l'Écoutoux. Sur les surfaces
de chevauchement "C.L." les linéations de mouvement acquièrent
un pendage SW ; celles portées par les chevauchements transversaux
acquièrent un pendage vers le NE (ces linéations
sont schématisées par des lignes en tiretés-points).
N.B. les 3 "phases" évoquées se réfèrent à celles définies à la page consacrée à la tectonique des massifs
subalpins septentrionaux (et dans la publication GIDON
M, 1981).
|
** Remarque concernant les plis
ayant une disposition en S, dont on rencontre plusieurs autres exemples dans le versant oriental de la montagne (notamment
dans l'entaille même de la route du Jalla) :
On peut penser
que ces plis ont la même origine que les chevauchements du Jalla (également
antérieurs à la formation de l'anticlinal de l'Écoutoux), car ces deux types d'accidents résultent les uns et
les autres d'un cisaillement de la pile des couches qui a déplacé
les plus élevées vers l'ouest par rapport aux inférieures.
Ils semblent donc relever en définitive de l'étape
la plus précoce de la tectonique compressive des massifs
subalpins septentrionaux ("phase P1"), qui a précédé l'étape
de formation des grands plis orientés N-S ("phase P2").
Cette interprétation n'est pas sans soulever une difficulté,
car il est indéniable que les plis représentés
ci-dessus "enroulent" une schistosité qui y
affecte les joints marneux (voir la figure 8 de la publication
n° 094). Or cette dernière ne semble
pas pouvoir être distinguée de la schistosité régionale,
que l'on a toutes raisons par ailleurs d'associer aux plis P2
: les microplis devraient donc être postérieurs
aux plis majeurs, ce qui est en contradiction avec l'enroulement
des failles inverses du Tithonique (au sujet de ces dernières
voir, en page "Chartreuse orientale", l'aperçu
général sur cette question). |
La route forestière du Jalla s'élève, depuis le restaurant du Père Gras jusqu'à son premier lacet, dans les calcaires
en petits bancs alternés de lits marneux du Kimméridgien.
Les deux lacets suivants recoupent les couches à bancs
calcaires plus épais du Kimméridgien supérieur,
puis les gros bancs du Tithonique inférieur, redoublés
par le chevauchement du Jalla au dernier lacet.
La plateforme supérieure du Jalla est
maintenant occupée par le "Mémorial des
Troupes alpines". Depuis cet emplacement un ancien chemin
d'exploitation mène au village de Mas Cachet. Il rejoint
d'abord, par 500 mètres de trajet horizontal et en partie
en encorbellement, l'entrée d'anciennes exploitations où
l'on voit les calcaires à ciment naturel du Berriasien
basal reposer sur le "hard-ground" du sommet du Tithonique.
Le chemin qui s'élève en direction
du Mont Rachais, depuis le large col boisé du Jalla,
décrit d'abord une succession de lacets qui s'inscrit essentiellement
dans les calcaires en petits lits (souvent de moins de 10 centimètres
d'épaisseur) du Tithonique moyen. Il laisse sur sa droite
les gros bancs du Tithonique inférieur qui forment le rognon du Bec
du Corbeau. Il franchit ces derniers au replat d'altitude 750
et s'élève ensuite dans les bancs du Kimméridgien
supérieur qui sont là redressés à
la verticale (voire légèrement renversés
vers l'ouest) : ce mouvement des couches correspond au crochon
induit par le chevauchement du Rachais qui traverse l'échine
(mais y est masqué par des éboulis) vers l'altitude
de 820.
 Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",
l'aperçu
général sur cette question.
Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",
l'aperçu
général sur cette question.
La description et l'analyse de la structure de La Bastille ont fait l'objet de la publication n°094.
cartes géologiques au 1/50.000° à consulter : feuilles
Grenoble et Domène
Carte géologique simplifiée (fond topographique d'après la carte IGN au 1/100.000°)
N.B. Les localités entre parenthèses appartiennent à une autre section du site et leur page s'ouvrira avec l'en-tête correspondant à cette dernière.
Aller à la page  d'accueil du site
d'accueil du site
Dernières retouches apportées &a22/04/24-->-->-->-->-->-->-->
![]() Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",
l'aperçu
général sur cette question.
Concernant les failles antérieures au plissement en Chartreuse voir, en page "Chartreuse orientale",
l'aperçu
général sur cette question.