Crête de Combe Bénite, Roche à Thomas |
Le tronçon des montagnes de rive droite de la moyenne Tarentaise qui est compris, sur la transversale d'Aime, entre les vallées du torrent du Cormet d'Arèches et du Nant de Tessens est constituée à sa partie haute, occidentale, par le chaînon NW-SE de Combe Bénite. Ce dernier se détache au Crêt du Rey de la crête de partage des eaux avec le bassin du Pontcellamont et se termine par les pitons rocheux de la Roche à Thomas. Au sud-est de ce sommet cette crête fait place au large versant, abrupt et assez boisé, de la rive droite de la vallée de l'Isère, dont les pentes s'atténuent, au niveau des villages de Tessens et de Granier, avant de rejoindre le lit de la rivière à Aime.
La crête de Combe Bénite est sculptée essentiellement dans la succession à l'endroit du flysch de Tarentaise de l'unité de Moûtiers, dont les couches se succèdent en contact stratigraphique normal sur des calcschistes du Jurassique moyen. Ceux-ci, dans lequel s'est creusé le talweg du Ruisseau des Douves représentent la semelle d'un chevauchement qui redouble ici le matériel de cette nappe en le faisant reposer sur les niveaux similaires de l'unité plus occidentale du Crêt du Rey , qui sont effectivement rebroussés en crochon.
Cette géométrie est typique d'un chevauchement, mais celui-ci n'a cependant été considéré par les auteurs que comme un accident secondaire au sein de la nappe dite "Unité de Moûtiers" car sa surface se raccorde dès le fond de vallon du Boulissoir à la bande de gypses qui y jalonne le chevauchement principal de cette nappe.
Dans la partie la plus haute de la crête les couches du flysch de Tarentaise et ses conglomérats basaux y sont ployées par un ample synclinal de la Combe Bénite, pli qui se suit d'ailleurs assez loin plus au sud. Mais en réalité ce pli affecte un système de plis couchés qui sont visibles dans les abrupts du revers NE de la crête, au cœur desquels affleure même les couches du Jurassique moyen du subtratum stratigraphique normal de ces conglomérats.
Mais le style tectonique change assez franchement plus bas sur la crête, au niveau de la Roche à Thomas : ce double sommet se détache en saillie parce qu'il est presque entièrement constituée par la formation conglomératique basale du flysch de Tarentaise, laquelle y est affectée d'imbrications impliquant les marno-calcaires de leur substratum normal qui y sont en outre replissées de façon complexe.
D'autre part ces plis ne prolongent pas ceux de la crête de combe Bénite : ils en sont séparés par une cassure oblique à la crête, qui se poursuit dans le versant ouest de la montagne en déterminant le verrou derrière lequel est retenu le Lac du Guio.
C'est apparemment cette cassure qui biseaute l'extrémité nord-orientale de la lame de calcaires liasiques de la Roche de Janatan dans les pentes de rive gauche du torrent de Tessens (voir la page "Villette"). En définitive cet accident, orienté NE-SW et de pendage subvertical, semble bien avoir un rejet coulissant dextre, de sorte que l'on peut le désigner comme le décrochement de la Roche à Thomas.

|
La Roche à Thomas vue du nord-ouest, d'avion. d.rT = décrochement de la Roche à Thomas : l'éclairage, encore matinal, souligne l'abrupt de faille par son ombre. |
| Le décrochement de la Roche
à Thomas semble même être une cassure assez
importante. En effet les données de la cartographie (voir
la carte) portent à en poursuivre
le tracé vers le SW, en passant en bordure nord-ouest
de la barre liasique de la Roche de Janatan, jusqu'au col nord
du Quermoz et, au delà, dans les pentes du versant de
Naves. En sens opposé (vers le NE) il semble aussi se prolonger selon un tracé passant par Pra Pinet, le long duquel on observe un assez flagrant décalage des entités structurales successives dans le sens dextre, et au delà jusqu'au front de la zone houillère briançonnaise en rive gauche de la vallée de l'Ormente (voir la page "Mont Rosset"). Ce décrochement montre en outre une parenté avec la faille de la moyenne Tarentaise : il a le même sens de rejet, même si ce dernier est plus minime, et leurs azimuts sont très proches. Son tracé semble même l'amener à se connecter à ce dernier à l'ouest de Bourg-Saint-Maurice, dans le secteur du vallon de l'Arbonne, de sorte que l'on serait tenté de considérer le décrochement de la Roche à Thomas comme une cassure secondaire induite par le jeu de la faille de la moyenne Tarentaise. |
La structure du versant qui tombe sur Tessens, La Thuile et Granier présente des complexités qui sont examinées à la page "Villette". Un des points qui le concernent est le tracé de la limite entre l'unité de Moûtiers et celle du Roignais que les auteurs de la carte géologique font passer en contrebas des escarpements orientaux de la Roche à Thomas (chevauchement de Pra Spa et des chalets de Thiabord). Mais cette interprétation est d'autant plus difficile à suivre que le dessin de la coupe de ce sommet fournie dans la notice de la carte en donne une représentation notoirement erronée : elle y figure en effet une ample voûte anticlinale à cœur de quartzites et de Permo-Trias qui est totalement absente sur le terrain, mais en fait clairement inspirée de celle du secteur (plus septentrional) de Portette, par une pétition de principe.
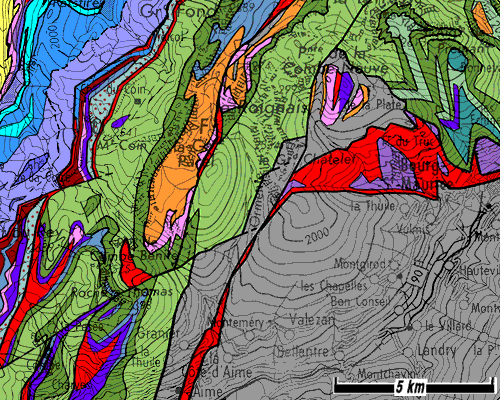
|
|
|
|
|
| Bagnaz | LOCALITÉS VOISINES | Grand Chatelet |
|
|
|
|
|
|
|
|